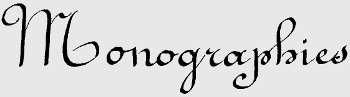Préambule
Ce texte – resté inédit – est à l'origine un tapuscrit de 13 pages aux lignes serrées, rédigé en 1940, en pleine guerre, par le Dr Pierre Tison, historien local, bon historien de l'art et connaisseur en religion, amoureux de sa ville. Il en avait confié une copie à Lucien Durin, un autre historien local, qui s'en est abondamment servi pour rédiger plusieurs publications remarquables, d'une grande clarté, notamment une synthèse parue dans « Jadis en Cambrésis » (n° 52, mars 1992)
Lucien Durin ayant fait don de ce texte au fond local de la Médiathèque du Cateau, il a été possible de le retranscrire pour le rendre plus facilement disponible. En l’absence d'une publication majeure sur cette église si remarquable, ce texte est important, avec les descriptions faites dans leurs ouvrages sur l'histoire du Cateau par le Dr Cloëz(1895) et l'Abbé Méresse (1904). Il est aussi émouvant par sa grande sensibilité.
J'ai respecté la mise en page du Dr Tison, mais j'ai été amenée à modifier parfois la ponctuation et (souvent) supprimer de nombreuses majuscules.
Le texte, annoté et illustré par Philippe Barbet est paru dans « Jadis en Cambrésis » (n° 134 et n° 135, 2021)
Christiane Bouvart
L'Eglise du Cateau : son histoire
Jusqu'à la Révolution, ce fût l’Église d'une ABBAYE Bénédictine, le monastère de Saint André du Cateau, fondé en 1022, et qui dura 8 siècles.
Elle devint alors Église Paroissiale St MARTIN, en remplacement des Églises St Martin et Notre-Dame, vétustes et sans valeur artistique.
L’Église S-Martin se trouvait sur la « Place Verte », l’Église N-D « de la Halle » était en plein Marché, « sur la Halle » ; des cimetières les entouraient : la Chapelle du « Bon Dieu de Pitié » (1613) est le dernier vestige d'un de ces cimetières au cœur de la Ville.
Reconstruction de l’Église de St André du Cateau
L’Église actuelle fut reconstruite au cours du 17ème siècle comme Abbatiale (Église d'Abbaye) de St André du Cateau, en deux temps.
Nef et Portail, par l'Abbé Antoine de Montmorency, qui en demanda les plans au meilleur architecte de la Compagnie de Jésus, le Frère Jean du BLOCQ, auteur des chapelles des Jésuites de Valenciennes (actuellement Église Saint Nicolas), de Vaucelles, de Saint Omer et d'Aire-sur-la Lys (lycée actuel), qui rappellent par leur façades le genre nouveau dont Jean du Blocq s'inspira pour le plan primitif de notre portail, remanié depuis. La façade jésuite de Saint Omer porte au fronton la date 1629 ; à la même époque il fit le projet d'Aire, exécuté seulement en 1683, dès 1623, il s'intéressait à la nef future de Saint André ; collabora-t-il avec ses confrères architectes de la Compagnie de Jésus pour dresser le plan du Cateau ? Avec le Frère Huyessens qui venait d'élever la chapelle de Namur ? (Saint Loup, dont les lignes intérieures évoquent celles du Cateau) c'est vraisemblable, car l'Abbé de Montmorency était un véritable mécène pour la Compagnie à laquelle appartenaient 2 de ses frères, les R.P. François et Florent, provincial puis vicaire du Général de l'Ordre. Le plan de notre église doit être le fruit d'une collaboration harmonieuse : les « Devisses de Jean du Blocq », qui fut très souvent au Cateau pour avis, marchés, mensurations et y laissa son neveu, spécialisé, semble-t-il, dans la sculpture des « Pierres de Fondation », furent revues par Dom Nicolas de Mory, maître des œuvres, et Bénédictin du Cateau ; L'Abbé lui-même suivait de très près les travaux, envoyant « consulter » à Mons, s'entourant des conseils d'Amé Bourdon, ingénieur à Cambrai et des « Frères de Bouchain, religieux, signant » carriers leur acte de visite des travaux de l’église en mai 1634.
Cette année-là, 1634, la 1ère pierre « le premier caillou » disent les comptes de la Ville, fut posée le 15 mai par les maçons « au nom du Magistrat », malgré les menaces de guerre entre les 2 royaumes (phase française de la Guerre de 30 ans). Les tailleurs de pierre bleue, tel Simon de Maray de Cambrai, travaillaient alternativement aux arcades de l’église et aux Portes de la Ville dont on consolidait la défense activement. Le 15 septembre, l'Abbé entouré de son neveu le Prince de Robecque et de ses moines, plaçait, à son tour, la « Pierre angulaire » au biais de la nouvelle nef et du chœur ancien ; on retrouvait, à cette occasion, l'ancienne pierre de fondation, portant en caractères gothiques « JE FUS ICY ASSIS » et la date « 1506 » où chœur et croisées avaient été refaites après incendies et destructions de la fin du XVème siècle.
Nef nouvelle et portail (1634-1635)
En janvier, l'Abbé avait confié le soin des sculptures du PORTAIL et de la NEF à Maître Gaspard MARSY, qui avec l'aide de son frère Daniel, les achevait fin 1635 (date du portail) ; Maître Gaspard était un grand artiste cambrésien, auteur du JUBE de Saint Géry (Cambrai) ; élève de Jean de Bologne, il aurait étudié à Florence ; il fut lui-même le maître de ses fils Gaspard et Balthazard, nés à Cambrai en 1624 et 1629 ; professeurs aux Beaux-Arts, à Paris, ils travaillèrent aux sculptures de Versailles (parc et château, Bassin de Latone) ; le tombeau d'un roi de Pologne à Saint Germain des Près, le maître-autel de Notre-Dame de Calais sont aussi leurs œuvres. Maître Gaspard le père, approuvé par l'Abbé Antoine de Montmorency embellit, égaya aussi le plan à lui proposé d'une façade aux lignes sévères, type Saint Omer qui eût mal cadré avec l'ensemble pimpant et élégant avec tourelles, bannerolles dorées, grands arbres de l'abbaye, reconstruite en 1620-30 ; l'Abbé lui promit 50 florins de gratification pour ses « enrichissements », en plus des 1 450 convenus ; mais il ne les toucha jamais... en octobre 1635, l'Abbé de Montmorency mourait... Vit-il la fin de ses travaux ? C'est peu probable, car la GUERRE les avait déjà retardés puis interrompus « Entre autres, du 23 août au 8 septembre 1635 », jusqu'à « l'éloignement du Camp des François hors cette ville » précise le Registre des comptes.
Alors les gens de la cité, lit-on aux comptes du Magistrat, montèrent-ils aux remparts pour prêter main forte à la maigre défense ; la ville fit cuire une fournée de pain pour les nourrir... Mais ce ne fût qu'une alerte : les Français ne trouvèrent au Cateau que la garnison du Seigneur archevêque, Mgr Vanderburch, gardant et défendant au mieux sa neutralité de terre d'église et indépendante des Pays-Bas ; après quelques réquisitions, ils levèrent le siège et décampèrent.
L’église du Cateau pendant le temps des guerres
1635, date où la 1ère phase de reconstruction fut quasi terminée (avec voûtes de fortune et cloisons provisoires) fut le début d'une ère de calamités pour la région ; de nombreux réfugiés de Saint Benin, Reumont... étaient en ville ; malgré les efforts de l'Archevêque Seigneur du Cateau, les Espagnols y établissaient garnison ; grisés par leur « Nach Paris » de 1636, ils y vivaient comme en pays conquis... puis, dans la ville surpeuplée, la PESTE venait de faire son apparition : l'aide des Pères Récollets de Cambrai permit de juguler le fléau... Mais en 1637, les Français le 15 juin reparaissaient, dévastant Saint Benin, assiégeant et bombardant Le Cateau, et sa garnison espagnole ; la ville se rendit le 21 juin. La démarche des Bénédictins de Saint André auprès du Généralissime des armées de France, le Cardinal de La Valette alors au Favril près de Landrecies préserva la ville ; cependant, vers 1639, Le Cateau était occupé par les deux partis, évacué puis finalement démantelé sur les ordres d'Harcourt ; les habitants ne rentrèrent qu'en 1642, et partiellement. En 1646, nouvelle alerte... au mois de mai, le Duc d'Enghien campe aux portes... L’église et l'abbaye servent de lieu de refuge aux bourgeois et à leurs bestiaux « qui mangèrent le foin de Mr l'Abbé » relate le compteur du monastère. 1658 : les moines obtiennent des sauvegardes pour la cité « en juillet, du Vicomte TURENNE, lorsque ses armées sont aux environ de GUISE ». En 1667, nouvelles menaces... L'abbaye et « le Fort Saint André » font partie du dispositif de défense ; une Hobette * avec guetteur sont établis sur le vieux pignon de Saint André... en bas de la ville au bord de la Selle, les Récollets, récemment fixés au Cateau, ont eux aussi installé fortin et service sanitaire en leur couvent... (Rue de la République, groupe des maisons « Lieutenant Eugène Morcrette mort pour la France »). Mais ce ne fût qu'une fausse alerte...
* Hobette = cabane, maisonnette
En 1678 ; Le Cateau recouvrait sa tranquillité par le Traité de Nimègue qui plaçait ville et châtellenie en terre de France, sous la protection du Roi Louis XIV : à l'abri de la Ligne Vauban et de ses géniales forteresses, notre ville allait revivre en paix.
Deuxième phase des travaux : Clocher, dôme et chœur (1680-1700)
Avec la permission de Sa Majesté, les moines de Saint André purent à nouveau reconstruire : déjà, en 1660, sous Dom Jean Couvreur, coadjuteur du vieil Abbé infirme de Bonmarché, et successeur de l'Abbé de Montmorency, il avait fallu d'urgence reconstruire le cloître en ruines. (La pierre de fondation de ces travaux, jadis exhumée, est scellée dans le mur du Patronage, derrière la salle des œuvres). Pour l'abbatiale, en 1679, Dom Anselme Meurin, le nouvel abbé, confiait l'entreprise des travaux à Maître Jacques Nicolas, de Valenciennes. Le même maître maçon construira plus tard l'hôtel de Ville du Quesnoy et le beffroi actuel du Cateau. Dom Colomban et Placide, moines de St-André, achetèrent les chênes des charpentes et surveillèrent les travaux (sont-ce leurs caricatures, ces masques aux longues oreilles, au dessus des piliers du chœur ? La tradition le prétend...) Sur quel plan poursuit-on la reconstruction ? La Chapelle des Jésuites de Louvain terminée vers 1666 par le Frère Hesius présente transept et projet de coupole ; d'autre part, les moines de Saint Sépulchre de Cambrai étudient alors les projets de leur future abbatiale (l'actuelle Cathédrale de Cambrai, remaniée depuis) ; mais on y retrouve la disposition de notre église : transept, ébauche d'un dôme central, chœur et déambulatoire, enfin le clocher hors l’église, adossé au bras gauche du transept.
Messieurs de Saint Sépulchre, lit-on aux comptes de Saint André (8H. 982), avaient aimablement avancé « 200 louys d'or, pour bâtir notre Tour et le Chœur de l’Église », prêt gracieux d'abord remboursé dès 1697 ; ils durent aider leurs bons confrères du Cateau plus encore de leurs conseils que de leur or.
« Notre tour » : l’église en était dépourvue et même de clocher ; en 1634, pour édifier la nef neuve, on avait abattu le clocher, placé en avant de la croisée du chœur et mal en point. On éleva le CLOCHER actuel, et Jacques Perdry, maître fondeur de Valenciennes en livrait les cloches en 1682.
Dôme et chœur s'élevaient de 1690 à 1700 ; les 10 piliers de pierre bleue du chœur, comme jadis ceux de la nef, furent amené de Marbaix ; de nombreuses fournées de briques sortirent « les gros piliers qui soutiendront le Dôme du Transept ».
En 1700, les sculpteurs pouvaient compléter leur aérienne dentelle de pierre. Les continuateurs de maître Gaspard furent les Froment, Augustin et Baudhuin ; natifs de Tournai, ils avaient, à cette époque, été reçus Bourgeois du Cateau. Ils travaillèrent ensuite à l'hôtel de Ville et autres églises.
Les dauphins se jouant près de la couronne de France, qu'ils ont sculpté au déambulatoire, près du maître-autel, aux arcs de voûte, sont-ils un délicat hommage rendu au Seigneur du Cateau, FENELON, précepteur du Duc de Bourgogne et des Enfants de France, sous l'épiscopat duquel notre église fût terminée ?
Étude détaillée du portail et de l’église
Le portail de l’église et l’œuvre de Marsy
Le PORTAIL Du temps des moines, un jardin le précédait ; et les colonnes qui semblent abandonnées, à droite et à gauche, contre de longs murs de briques devaient alors décorer l'entrée : à droite de la cour de l'abbaye avec ses arbres, tilleul vénérable, puits monumental que dominait le statue de la Vierge, à gauche, des jardins des religieux ; l'on y montait par l'ancienne crypte de Saint Nicolas, tout ombragée de hauts chênes verdoyants... qu'abrita encore la propriété de M. Lozé.
Dans ce cadre, l'impression première eut été moins étrange de cette façade aux allures de retable espagnol par l'exubérance de sa décoration. Telle que la réalisa Gaspard Marsy, elle représente le type du style de notre Cambrésis en 1635 ; époque de RENAISSANCE aux Pays-Bas ; Rubens avait été le conseiller d'art des archiducs Albert et Isabelle, protecteurs du Cambrésis et de Saint ANDRE du Cateau. Le maître de Cambrai eut la bonne fortune de plaire à l'Abbé de Montmorency et de pouvoir faire œuvre originale.
Cette façade aux lignes académiques et froides (cf Saint Omer), il l'anima de sa verve et de son talent. Au rez-de-chaussée, il respecte le plan à lui remis en janvier 1634 ; pilastres et colonnes d'ordre dorique ; niches où furent installés plus tard Saint André, patron de l’église et Saint Mathieu, qui préside à la grande foire-marché annuelle de septembre. 7 marches de pierre bleue, comme les doubles colonnes et le fronton brisé, donnent accès à la porte d'entrée ; y alternent les armes de l'abbaye et de l'Abbé de Montmorency, encadrées de masques grimaçants...
Au premier étage, étaient prévues 3 statues : Saint André, flanqué de la FOY et de l'ESPERANCE : elles restèrent à l'état de projet... 2 ciboires et une statue plutôt moderne de la Vierge les suppléent actuellement, entre les pilastres ioniques.
Au second rang, l'art de Marsy se révèle : aux « ailes des carolles », correspondant aux bas-côtés, il a sculpté « deux Festons », guirlandes de fruits nouées d'un nœud de cordage ; au-dessus, il avait placé deux AIGLES ; Les aigles ont disparu... les remplaçaient, il y a 25 ans les inscriptions commémoratives : à gauche, Philippe IV, Regnante, 1635, nom de Roi d'Espagne, contemporain de la façade ; à droite, Napoléon III régnant, 1854, date d'une des nombreuses restaurations, car la pierre d'Ecaussines en Belgique, imposée au sculpteur, ne résista pas aux injures des siècles. A leur place, il y a un vide... Mais les deux pierres d'armoiries, en pierre bleue, arrivées toutes prêtes d'Ecaussines, ont résisté, elles, et aux injures des hommes... La Révolution respecta la mémoire des grands bienfaiteurs de l'abbaye : le monastère bénédictin et le fondateur de cette église, alors que tous les blasons des seigneurs archevêques furent mutilés... Les armes de l'abbaye sont d'ailleurs celles de la Ville : le Château Sainte Marie, fondé en 1007, et ses 3 tours, qui donna naissance à la cité « Chastel-en-Cambrésis », longtemps ville forte puis de plaisance des évêques de Cambrai. Et pour terminer la décoration de l' « Aile des Carolles », Maître Gaspard exécuta des « Pots à feu », qui sont des chefs-d’œuvre : des faunes, au sourire malicieux et couronnés de fleurs qui s'entremêlent dans leurs cornes, en forment le motif des vases. Le « Sourire du Faune » de Marsy, voilà l'une des curiosités de cette façade.
N.B. Les expression entre guillemets sont d'époque et tirées des « Comptes de Réduction du travail de Maître Gaspard, en Carême 1636 », sous le nouvel Abbé de BONMARCHIE.
Le 3ème étage était, à l’origine, moins chargé : un œil de bœuf central, éclairait les combles ; on en retrouve la carcasse du vitrail derrière l'« IHS » qui l'obtura ensuite. Marsy avait du respecter le plan initial : «au dessus de l'ovale du pignon, cuirace (terminale) de la date », (comme à Saint OMER), tout en agrémentant ce « viel pignon » de 3 « pots », moins importants que les Vases silvestres « des Ailes des Carolles » (on les lui paya moitié prix : 2 florins pièce.) St Charles Borromée, d'Anvers, ancienne chapelle des Jésuites, l’église de La Madeleine, dans LILLE, ont des frontons ainsi agrémentés de 3 pots à feu.
La décoration de ce dernier étage était à la mémoire de la Maison de Bourgogne, et c'était juste gratitude : les Archiducs décédés depuis peu, hélas, sans héritiers, avaient été la providence des Pays-Bas où ils devaient fonder une nouvelle dynastie de Bourgogne, autonome et pacifique. La mort les faucha trop tôt. Ainsi, Maître Marsy a-t-il sculpté les « Fusiz et X », emblèmes des Ducs de Bourgogne... Les Croix de Saint André (patron de Bourgogne) faites de 2 bâtons noueux d'épines (Qui s'y frotte s'y pique...) les réchauds enflammés et les briquets pour faire jaillir la flamme... Flamme du souvenir que cette allégorie de pierre... L’Archiduchesse Isabelle avait été la grande protectrice de l'abbaye : personnellement, elle avait obtenu le rattachement de l'Abbaye de FEMY à celle du Cateau, tout au moins le titre d'Abbé de Femy pour Dom de Montmorency, avec les revenus des biens, les Pères Florent et François de Montmorency, frères de l'Abbé Antoine, de la Compagnie de Jésus, avaient été les intermédiaires tout désignés pour ces délicates négociations ; les revenus ainsi accrus facilitèrent les travaux de l’église... et en permirent les fastueuses sculptures.
Fastueuse, est la FRISE « faite de Fruitaille », sous-jacente aux croix de Bourgogne : il en est trois qui séparent les étages. Celle-ci, la plus haute, où les poires et les pommes rappellent les deux grands festons de fruits ; les fruits au naturel... modèle cher au Maître de Cambrai, que nous retrouverons en abondance à l'intérieur de la nef, sur la frise y courant. La seconde, entre Ier et 2ème étage « faite de Morisques » ; (marguerites et arabesques). La frise inférieure, coupée par le fronton de pierre bleue et fort dégradée, « faite d'Aiglons, imparfaits », a écrit le compteur, au jour du paiement ; a osé écrire... chaque « Aiglon » est un travail fini et parfait, … comme les anges au dessus des ciboires et le « Satyre au dessus de la Verrière » (droit sous l' « IHS », immédiatement sous la frise de fruitaille et la nouvelle cuirace de date qui porte 1635. Cette frise d'aiglons mérite qu'on s'y attarde... l'Abbé de Bonmarchié et Dom Potier, « son prêvot », ayant été, injustes en leur jugement, ce « Jour de Carême de 1636 ». Les 16 aiglons offrant 8 sujets différents, séparés par des cannelures, c'étaient (car il en manque) : une ancre, une truelle (supposée) ; l'agneau sur un coussin cœur entouré d'une couronne d'épines ; la croix où s'enguirlandent des pampres de vigne, les clous de la Passion, échelle et lance, attributs de la Passion, enfin une tête d'Ange. Il semble que là comme partout, maître Gaspard n'a livré que du travail FINI.
Remaniement de la façade, Église bénédictine
A quelle époque, le fronton fut-il modifié et exhaussé ? Sans doute, à plusieurs périodes. Mais, à ce jour, il n'est permis que des hypothèses.
L’église, après la mort de Fénelon qui coïncida avec l'ouverture du Collège des Pères Jésuites en cette ville (1715), servit de Chapelle aux élèves plusieurs trimestres ; l'Abbé de La Cocquerie, fut, comme jadis Dom de Montmorency, très généreux pour les nouveaux maîtres : prêts d'argent ; leçons de philosophie et de théologie demandées aux Pères pour les novices du Monastère ; faut-il voir dans l' « IHS » rayonnant, entouré d'une Gloire, ma foi, bien enlevée, de chérubins le témoignage de gratitude des Pères envers les Bénédictins ou simplement le scel d'une longue amitié, au Cateau, des deux ordres ?
Quant à la croix terminale, avec tête d'ange, globe terrestre, sur un socle timbré de l'A.M. Marial et l’œil de Jéhovah, inclus dans le fronton triangulaire, cette masse architecturale doit incomber à M. de Baralle qui eût à restaurer la façade après la Révolution ; il n'y avait pas ou plus de croix, écrit-il dans son rapport ; il crut bienséant d'en remettre une et compliquée. Ce fut peut être nécessaire, pour dégager par en haut, la perspective de la façade, privée de son complément séculaire, l'abbaye, et emprisonnée depuis entre deux murs de brique...
Intérieur de l’église : aperçu général
Ses dimensions imposantes frappent de prime abord : 68 mètres de long, une NEF de 30 m, un vaste chœur de 30 m, aussi, séparés par le transept au dôme harmonieux, long de 8 mètres. Les 20 colonnes de pierre bleue, 10 pour la nef, 10 au déambulatoire du chœur soutenant les arcades, d’où monte la voûte à 16 mètres de hauteur, limitent le vaisseau central, large de 9 mètres ; les bas-côtés sont étroits.
Il s'agit d'une église faite pour les Bénédictins, les bas-côtés destinés à doubler le cloître, pour la longue file des moines, gagnant en procession, à l'heure des offices, leur stalles du sanctuaire... Chœur immense, pour que puisse s'y déployer la pieuse liturgie de la louange divine... Nef spacieuse pour la foule des fidèles puisse s'y presser les jours où le Révérendissime Abbé officiait pontificalement ou que la dévotion envers Sainte Maxellende, dont l’église abritait la châsse protectrice attirait les pèlerins, ainsi que le 22 septembre, de chaque année. Ce jour-là, la Ducasse commémorait la dédicace de la Ière église de Saint ANDRE, en 1025, et la Translation des reliques de Sainte Maxellende, au autre 22 septembre, d'une année suivante ; derrière la maître-autel, élevé à la place du grand crucifix, au dessus de la chapelle absidiale, brillait la châsse, actuellement le joyau de l’Église de Caudry. Le baptistère est ce qui reste du cloître du monastère ; par là se faisait aux solennités l'entrée des moines ; la sacristie fut longtemps la chapelle du Père Abbé ; un couloir la reliait avec l'Abbaye et le Chœur ; par là aussi, le matin, pour réciter ou chanter nocturnes et laudes, passaient les moines se signant d'eau bénite dans une piscine aux fleurs sculptées... qui existe encore derrière la soufflerie des orgues du chœur.
La nef de l’église
- L'emploi de l'arc brisé gothique dans les voûtes des bas-côtés ou « carolles » ; il associait volontiers gothique et roman, fidèle ainsi aux traditions de son maître, le Frère Henri Homaker, de Tournai ; il avait aussi, pour l'éclairage de la nef, prévu des « OVALES ».
- L'emploi de ce mode d'éclairage par « œil de bœuf » est la seconde curiosité architecturale.
Maître Gaspard les entoura de sculptures, les souligna de « grandes cartouses » : ce sont alternativement des écussons à banderolles et de larges coquilles. Son grand travail, ce fut la frise courante en la nef, d'un pilier à l'autre et derrière la façade ; avant que le buffet d'orgues ne soit rétabli, il y a 10 ans, on pouvait l'admirer ininterrompue, cette guirlande de fruits croqués au naturel : pommes, poires, noisettes, melons, raisins... des écussons la coupent et au dessus des piliers y nichent des « Chérubins ». Têtes d'anges ailés, vivants, frisés, les ailes en coup de vent, avec un toupet à la Riquet à la Houppe, ce sont bien les anges poupards de Marsy, si chers au maître de Cambrai qu'on a voulu y voir sa marque de travail ; on les retrouve aux portes des bahuts, aux tiroirs des « armoires à poupards » du Cambrésis, avec les guirlandes de fruits et Satyres grimaçants, comme dans la nef du Cateau. C'est aux clefs des arcades que maître Gaspard a sculpté des « Satyrs » ou « Morisques » aux masques hallucinants. Tous sont différents ; certains sont des chefs d’œuvre. Celui qui décore la clef de la Ière arcade, à gauche en entrant dans l’église, après le buffet d'orgues, mérite qu'on le détaille : c'est le Masque de la Désespérance... un rictus de douleur crispe ses traits ; est-ce un transfuge de l'Enfer de Dante qui vient clamer son éternel désespoir aux vivants d'ici-bas ? Son vis-à-vis est aussi étrange ; d'ailleurs chaque sculpture de Marsy doit être longuement contemplée, étudiée, méditée... et les jumelles, comme la reproduction photographique permettent de saisir l'intense vie que ce grand artiste a su insuffler à son œuvre, parfois badine, souvent émouvante.
Ces gracieux chérubins ont été estimés par Messieurs de St André, lors de leur fameuse reddition de comptes de Carême 1636, 5 florins pièce et les « Satyrs », 25 patars l'un, soir un florin et quart, et le reste à l'avenant...
Ainsi l' « enrichissement » de la porte allant de l’église au cloître... payé 10 florins ; c'est l'actuelle porte d'entrée du BAPTISTERE, à droite en pénétrant dans l’église : Deux paons soutiennent un fronton à volutes, brisé par une pierre de marbre et surmonté d'un vase garni de fleurs en un bouquet serré ; le marbre porte l'inscription « JANUA VITAE SPIRITUALIS », « Porte de la Vie spirituelle »...
D'autres travaux du « tailleur d'images » embellissaient le cloître ; déjà, en 1636, ils avaient partiellement disparus... « enlevés par ordre du Dominicain »... Ainsi, de son vivant, maître Gaspard ne fut-il point louangé et porté aux nues, tout au moins au Cateau... la postérité lui a donné sa revanche.
L'église nouvelle : Chœur et transept, tour (1680-1700)
C'est l'époque valenciennoise de la construction : continuité dans l'unité d'un plan ; les nouveaux architectes ne furent pas des novateurs.
Et cependant, il y a des perfectionnements : de hautes fenêtres inondent de lumière le chœur et le transept ; les arcs des bas-côtés sont arrondis en anse de panier ; par contre les colonnes du chœur se rapprochent derrière l'autel en travées plus étroites, supportent des arcades d'abord arrondies puis ogivales... réminiscence de l'ogive, comme aux voûtes des carolles anciennes.
La tour s'élève. Elle est carrée, robuste, trapue ; huit contreforts la flanquent jusqu'au dessus de la chambre des cloches : 4 cloches, sortant de la fonderie de Jacques Perdry, Valenciennois, et pesant 4 446 livres y furent hissé vers 1682 et payées 3 149 florins, en 7 annuités. Une flèche d'ardoises la couronne, terminée en bulbe qui soutient une croix de fer forgé. Beaucoup de clochers bulbeux datent de cette époque : celui de Saint Martin, c'était au Cateau. Le clocher de Solre-le-Château est l'un des plus représentatifs de la région. Elle est peu ornée : les «œils de bœuf » sous la chambre des cloches, aux 4 côtés, sont entourés d'un cadran, fleuri de marguerites aux quatre angles; au dessus, des croix de St André, auxquelles correspondait, au dessous les armes de l'abbaye, disparues avec la Révolution.
Ces marguerites, on les retrouve dans la décoration florale du dôme, où elles sont posées comme des cabochons ; les frères FROMENT,(Augustin et Baudhuin) semblaient affectionner cette fleur, lorsqu'en 1700, ils ont continué l’œuvre de MARSY. La frise courant dans le chœur est fait de fleurs et de fruits, et non plus de fruits seuls, comme dans la nef ; et lorsqu'elle s'étire aux quatre coins du vaste et somptueux transept, des anges y apportent des palmes et du feuillage. Des anges encore sont les célestes agents de liaison de toute cette offrande des dons de la nature à « l'agneau divin ». L'agneau « triomphant et toujours immolé », placé sur l'autel du ciel, tel semble être le point final, l'aboutissement de toute l'ornementation sculpturale de l'église : entouré d'une gloire, il trône au fond du sanctuaire, au dessus de l'autel de la terre, sur un tabor. Une tête d'ange le soutient, et, encadrant l'agneau, des guirlandes de fleurs et de fruits montent jusqu'à la colombe, aux larges ailes étendues, protégeant le sanctuaire « à l'ombre de ses ailes »...
Les Beaux-Arts ont bien fait de nous restituer ce beau motif du voûtain du chœur, après les dévastations d'octobre 1918... à la place de l'agneau, M. de Baralle, en 1873, alors architecte diocésain et départemental, avait installé les armes et le chapeau de cardinal de Mgr Régnier, lors archevêque de Cambrai : ainsi avait été rétabli le plan initial des maîtres de l’œuvre.
Il faut reconnaître la différence de facture et de maîtrise : les têtes d'anges du chœur ne sont plus les chérubins poupards à la Marsy : les anges des Froment sont plus académiques ; ils portent perruque soignée, à la façon du grand siècle et du grand Roi, comme pénétrés par la majesté du saint lieu : leur sérieux contraste avec les grimaces des satyres dont le plus grimaçant surplombe le maître-autel.Moins pathétiques que ceux de Marsy, certains ont un mufle de chien de garde ou un masque de carnaval.
L'église : caricatures du chœur, dentelles du dôme
La malice des sculpteurs a mis aussi une note amusante en cette solennité, tels leurs devanciers des gargouilles gothiques. En plus des deux pauvres moines aux oreilles d'âne (Dom Placide et Columban...) qui continuent leur surveillance, sous deux consoles, au dessus des piliers du chœur, les plus proches de l'accès vers la sacristie, il y a d'autres faces humaines... Tout en haut, dans les festons fleuris montant vers la colombe, on découvre 2 têtes narquoises... signature d'un maître ouvrier ou la tête caricaturée des frères FROMENT ?
Dans la décoration du TRANSEPT grandiose et puissant, il n'est plus question de plaisante facétie... large de 8 mètres, étendant ses deux bras carrés sur plus de 26 mètres de longueur, il unit à merveille les nef et sanctuaire par son DOME aérien. Il s'élève majestueux de la croisée du transept, à 16 mètres soutenu par 4 gros piliers de briques massifs et trapus, recouvert sur leurs pans, de pierre grise et s'accolant aux demi-colonnes terminant la nef et ouvrant le chœur... De riches chapiteaux corinthiens les allègent au niveau de la frise courante ; les anges ailés y font escorte aux têtes de lion, d'aigle, de taureau et à leur collègue l'ange qui représentent suivant l'Apocalypse, les quatre évangélistes.
Une dentelle de pierre, de la même facture qu'au fond du sanctuaire, décore le DOME de Saint ANDRE. Ici, c'est vraiment le triomphe des anges... légers et délurés, ils grimpent, s'aidant des lianes fleuries comme d'une ECHELLE de JACOB, à l'assaut de la couronne centrale, dessinant au départ des piliers une gigantesque croix de Saint André ; d'autres festons fleuris dessinent une étoile à quatre branches : exubérante décoration florale ; de grosses marguerites (les fleurs favorites des Froment...) en forment nœuds et cabochons.
Et, plaqués dans les espaces libres, quatre têtes d'anges semblent planer, comme du firmament au sommet de cette église qui aurait du recevoir le titre de « Saint André des anges ».
Mais nos sculpteurs avaient à parachever l'ornementation de l'édifice.
D'abord, la chapelle absidiale, dédiée à Sainte Maxellende, au dessus de laquelle était élevée sa CHÂSSE.... Puis la chapelle Notre-Dame, devenue la sacristie. Croix de Bourgogne, guirlandes de fleurs en embellirent les antiques nervures, et les pendeloques (disparues). Très ancienne, cette chapelle, restaurée en 1630, avec son petit chœur à trois pans, aveuglé par le mur droit du nouveau chœur de la grande église, et les deux fenêtres qui l'éclairent ; les vitraux d'avant la guerre 1914-18 y sont demeurés intacts. L'ancien couloir du monastère qui desservait à la fois l'entrée de cette chapelle (qui fut abbatiale, en son bénitier orné de leurs temps) et une entrée du chœur (à l'emplacement de l'orgue d'accompagnement) a conservé une piscine bénitier orné de fleurs.
Dans le bras droit du transept, au dessus du confessionnal, il est un « Oeil de Beuf » élégamment entouré de fleurs de lys sculptées dans la pierre grise... Est-ce l’œuvre des Froment ou leur fut-elle antérieure que cette décoration fleurdelysée d'une lucarne du cloître ? La nuit et à toue heure, les Bénédictins pouvaient, par cette ouverture, d'une de leurs cellules veiller sur le tabernacle. Un vitrail aux armes du Cateau (celles aussi de l'abbaye) l'obture actuellement : sur le mur extérieur entre transept et baptistère, on peut voir des vestiges du cloître de Saint André.
Fin des travaux de sculpture de l'église
En 1701, s'acheva la décoration « de toutes les arcades » non seulement du chœur mais aussi de la nef, voûtes de la nef, voûtes des bas-côtés, « intrados » entre les piliers... partout où il fut possible de sculpter, le ciseau des frères FROMENT s'en donna à cœur joie...
Où trouvèrent-ils leurs modèles ? Dans les enluminures des vieux manuscrits, ils copièrent ces envolées d'oiseaux ou ces perruches perchées sur des arbres... (arcades des piliers derrière le maître-autel, les « petits oisons de la Toison d'or », suspendus à un ruban avec un gros gland terminal (arcades de la nef, les plus proches de la chaire prédicatoire) motif qu'ils n'ont pu que GRAVER dans la pierre trop dure, pierre bleue de Marbaix qui n'était pas destinée à l'origine à être sculptée.
Chaque arcade, chaque motif différent, se faisant vis à vis : médaillons, losanges, berceaux de feuillage, bouquets de fleurs, guirlandes de fruits, tous exécutés avec art.
Nos sculpteurs ont-ils choisi, au déambulatoire, des sujets d'actualité ? Entre la sacristie et le maître-autel, on voit aux voûtes des carolles, des dauphins escortant une couronne royale, entre des branches d'olivier et des gerbes de blé... voulaient-ils célébrer la paix et l'abondance, la couronne de France et les élèves du Seigneur Archevêque Fénelon.
Peut-on essayer de traduire le SYMBOLE de cet ensemble d'ornements ? Dans « ce Temple, orné partout de Festons Magnifiques », les anges apportent à l'agneau immortel, les prémices des quatre saisons, chantant la LOUANGE de la nature envers son créateur, l'ALLELUIA.
En 1714, Jean PAVOT, « escrinier »* catésien terminait les stalles que Bavier avait sculptées. Pierre COUSIN, ferronnier, comme les précédents du Cateau, posait « les 9 panneaux et les deux Portes de travers » des grilles du chieur en 1717, sous l'Abbé de la Cocquerie ; nous en apprécions toujours le travail délicat.
BOITTIAUX, de Cambrai, sculptait le buffet d'orgues, dans le style régional avec angelots et guirlandes de fruits et fleurs, (il fut refait suivant le modèle ancien, il y a 10 ans.) en 1719. CARDON, facteur d'orgues à Douai, avec BOSQUET, son assistant et GOBER, son ouvrier livra les orgues de l'église de 1719 à 1721 ; coût : 3 684 florins. Les orgues actuelles sont modernes.
* N.B. Escrinier = Fabricant d'écrins, de coffres
Mobilier et trésor au XVIIIe siècle
L'inventaire fait à la mort de l'Abbé de la Cocquerie en 1746, donne connaissance du TRESOR et du mobilier de l'église, à cette époque :
Le maître-autel était en bois et creusé comme un coffre avec un tabernacle « d'argent travaillé en relief » ; par dessus « un Crucifix d'argent sur bois avec au pied la Vierge et un St Jean d'argent » ; de chaque côté du tabernacle, 2 anges adorateurs (peut être les actuels?) en bois tenant un bouquet de fleurs artificielles. Sur l'autel, 4 grands chandeliers d'argent pesant chacun 200 onces ».
Des antipanes et gradins tendus de tissus aux couleurs liturgiques garnissaient l'autel : en soie brodée d'or aux grandes fêtes. Ces jours-là, les reliques insignes brillaient de chaque côté du tabernacle : celles de Saint André et de Sainte Maxellende, patrons de l'église ; les reliquaires étaient des statues d'argent, avec soubassement également en argent contenant les reliques, et soutenus par des boules d'argent. La statue reliquaire de Saint André pesait 120 onces et avait été faite en 1609 ; celle de Sainte Maxellende en 1598 et pesait 116 onces. (une once = 30 grammes).
Il y avait aussi une Vierge Marie avec le Petit Jésus, en argent, travail de même orfèvrerie, datant de 1611 ; deux bras d'argent formant reliquaires et deux « Pyramides en fleurons d'argent travaillés en relief sur du velours rouge » fixées sur des planches, au milieu desquels les « effigies de Saint André et Sainte Maxellende avec les reliques des Saints Fortunat et Juste, martyrs ».
Les jours solennels où « monsieur l'Abbé officiait », les quatre chantres revêtaient des chapes « en pluie d'argent, avec orfrois en étoffe de soie bleue fleuragée » et les deux pré-chants portaient, en signe de leur dignité, les «Batons d'argent » décorés de « deux anges qui tiennent séparément les Armes de la Maison et celles de Monsieur Meurin » (qui fut abbé de 1679 à 1701).
La chape de l'abbé, les jours de pontifical blanc, était « en damas à fond blanc fleuragé » ; sur les orfrois, des broderies d'or et d'argent reproduisaient les armes de Maison et de Monsieur de Montmorency (décédé en 1635). Sur la mitre précieuse, étaient brodés « quatre portraits, en avant la Vierge et Sainte Barbe, par derrière Saint Benoît et Saint Gisle », « en fines perles » : des pierres multicolores la décoraient jusqu'aux brandons d'argent. La crosse était d'argent doré, « de 6 pieds et demie de hauteur ».
Dans les coffres de la sacristie, étaient conservé « un plat de cuivre jaunes avec le CHEF de St Jean-Baptiste » de la grosseur d'un poing et « doré sur les cheveux et la barbe, avec 18 petits rayons l'entourant » (renfermant sans doute une relique du précurseur, qui avait sa chapelle dans l'ancienne église en 1630, un autre plat d'argent, ovale et doré sur les bords, portait en relief « et aussi dorées, es armes de M. de Montmorency ».
Parmi les croix du trésor, il y en avait une « en argent travaillé sur bois, avec reliques de la vraie croix et petites croix à reliques enchâssée, et pierres précieuses » ; ce beau travail d'orfèvrerie (fin du XVIème) est le seul souvenir qui nous soit demeuré du trésor de Saint André.
Un registre « long et étroit » conservait, à la sacristie, les « noms des confrères et consœurs de Sainte Maxellende » ; fondée en 1671, cette confrérie avait la charge de la « lampe d'argent », pendue vis à vis de la châsse et sans cesse allumée en l'honneur de la Sainte et de Saint Sare (prêtre martyrisé à Lambres près Douai). La châsse renfermant leurs reliques « se trouvait enchâssée dans la muraille », dit l'inventaire, « au dessus de l'arcade de la chapelle ».
Chapelle de Sainte Maxellende : l'autel « orné de pilastres et de sculptures » fut exécuté à Valenciennes en 1722 ; il encadre un tableau « où la Sainte et représentée comme FOULANT aux pieds LE DEMON DU FOL AMOUR ». Il fut retouché depuis : le fond évoque le CHASTEAU d'antan et les clochers nombreux de la cité... La chapelle est surélevée : elle recouvre le caveau des abbés de St André, prédécesseurs de l'Abbé de le Cocquerie y furent placés avec sa propre dépouille... Ce caveau, pas plus que les nombreuses tombes et sépultures de l'abbatiale ne durent être violées lors de l'époque révolutionnaire.
Autels du transept : Ils se faisaient vis à vis, placés sous les verrières. Dans la croisée gauche, l'autel de la Vierge avec un tableau représentant la Vierge, Saint Joseph, le petit Jésus et Saint Jean-Baptiste.
L'église de 1710 à nos jours : histoire et mobilier
A droite, l'autel de Saint Benoît « travaillé comme celui de gauche avec pilastres et sculptures » (exécuté en 1737 par un Valenciennois) avait aussi son tableau ; il a survécu... il est au dessus de la porte de la sacristie ; on y voit « le MIRACLE qu'opère Saint Benoît en la résurrection d'un enfant ».
Le maître-autel date de l'abbatiat de Dom Pierre MEREAU (1746-1770) l'avant-dernier abbé de Saint André ; de marbre veiné noir et gris, il porte, en une élégante coquille de bronze doré les armes de l'Abbé MEREAU « une ROSE » ; « Suavem mittit odorem » : elle répand un parfum suave ; telle était sa devise.
On la déchiffre encore sur sa pierre tombale, dans l'axe de la nef centrale. 46 sépultures ont été dénombrées en l'église : la plus ancienne est de 1682 : y repose Messire Charles de Fiennes d'Alembon, « châtellain du Château-Cambrésis ». Deux Pères Jésuites de la ville, les Pères Selichen et Hugo Boursier (1741 et 750), un Récollet, Nicolas Duchemin y sont enterrés au milieu des Bénédictins.
Lors de la Révolution, les morts furent respectés dans le Temple de l'Être Suprême, lorsque Le Cateau s'appela « Fraternité-sur-Selle ». Mais on eût à déplorer la vente de la châsse Sainte Maxellende aux habitants de Caudry avec ses précieuses reliques. Ils la préservèrent de toute profanation. A la même époque (exactement le 3 septembre 1792), Jean Vilette, un Catésien, ancien officier en retraite, tombait, victimes des massacres de Saint Firmin, à Paris ; c'est le Bienheureux de Vilette, élevé sur les autels , comme martyr de la Foi (chevalier de l'ordre de Saint Louis, on l'appelait « le chevalier Jean de Vilette ». Son souvenir devait être cher à ses concitoyens. Pourquoi ne pas invoquer son intercession avec la même confiance que nos ancêtres mettaient en Sainte Maxellende, émigrée à Caudry ?
En 1914, le 26 août, l'église connut l'invasion allemande : l'ennemi y enferma les soldats anglais et français faits prisonniers. En octobre 1918, les Anglais délivrèrent le Ville : l'église eut beaucoup à souffrir du bombardement, mais elle échappa à l'incendie qui détruisit une partie de la Place au Bois et les derniers vestiges de l'abbaye avec les maisons voisines, où s’élèvent à présent la salle d’œuvres, et l'hôtel des Postes.
Une station du colossal Chemin de croix, placé dans l'église au cours du 19ème siècle a été préservée : elle se trouve dans la partie gauche du déambulatoire, au dessus de la porte du clocher ; à côté, un vieux confessionnal de 1770 avec de fines sculptures dont un Saint mitré. Un autre confessionnal digne d'attention, est dans le bras droit du transept. Il est en face de l'autel de Saint Martin, érigé comme l'autel de la Vierge, au cours du siècle dernier : les statues de Saint André et de Saint Mathieu, patrons de l'abbaye et de la ville, y escortent le patron de la paroisse, Saint Martin. Sainte Maxellende et Sainte Reinelde (de Condé, qui avait sa chapelle et fontaine de dévotion aux pieds des remparts du Cateau) accompagnent la Vierge, à son autel. Le buste reliquaire de Saint Martin (jadis Saint Ghislain) et une Vierge du 17ème siècle, aux yeux d'émail (classée par les Beaux-Arts) sont avec les somptueuses broderies du dais processionnel (en partie sauvées) et la croix reliquaire, les plus beaux souvenirs du passé. Les deux crucifix, l'un face à la chaire (ancienne elle aussi), l'autre, au fond du chœur où il a remplacé la châsse de Sainte Maxellende, sont des œuvres d'art. Viennent-ils de l'abbaye, de la salle du Chapitre ou d'un couvent de la ville ?
L'église : reconstitution d'après-guerre 1914-1918
En plus des 2 paroisses, et du monastère des Bénédictins de Saint André, la ville comptait deux couvents de religieuses Augustines, jadis hospitalières et devenues 20 ans avant la Révolution, enseignantes : le Saint-Esprit Rue Saint Martin, plus bas que la Place Verte, et Saint Lazare, en bas et à gauche de la Rue Pasteur. Et celui des Récollets, près de Saint Lazare, Rue de la République, ainsi que le Collège des Jésuites. Chaque Maison avait chapelle et clocher ; sans oublier la Chapelle Sainte Catherine, desservant le palais des Archevêques. Des statues, qui en furent sauvées par la piété populaire, sont rassemblées autour du « Dieu de Pitié » et d'une « PIETA » de pierre coloriée, dans la vénérable « Chapelle du Bon Dieu », ruelle entre la Place et la Rue Pasteur. C'est un intéressant musée du « folklore religieux » du Cateau.
Le maître-autel de l'église, endommagé par le bombardement d'octobre 1918, a reçu une nouvelle parure : des chandeliers de bronze doré, deux candélabres de même style Louis XV et la coupe de la lampe du sanctuaire ont été choisis et exécutés avec un goût parfait. Deux toiles du XVIIIème ont pris place dans le pourtour du chœur : à gauche, une scène biblique « Le sacrifice de la fille de Jephté »; à droite, une « Adoration des Mages ». Les Rois Mages avaient droit de cité en notre église, car leurs reliques y avaient été apportées le mercredi d'après la Pentecôte 1049 (« Annales de l'Abbaye ») et, des siècles durant, vénérées par les fidèles avec beaucoup d’honneur.
Le chemin de croix de teinte grise, n'est pas mis en valeur, comme il le mériterait (œuvre de Vermaëre, qui rappelle celui de Saint Géry de Cambrai, du même auteur.
La statue du Sacré Cœur, adossée à l'un des piliers du chœur, est un travail de grande allure ; sobre et de lignes classiques, elle fut exécutée spécialement pour notre église par le sculpteur Hartmann : elle y est bien à sa place.
Quant aux VITRAUX, ils s'inspirent de la technique moderne et déversent des flots de lumière multicolore ; leurs coloris en sont souvent crus et volontairement heurtés ; mais quelle richesse dans la gamme des tons...Les sujets ont été judicieusement choisis. Dans le chœur, l'Ancien Testament, avec MOÏSE, MELCHISEDECH, et les SIBYLLES, aux robes vert, indigo et jaune ; les quatre évangélistes éclairent le déambulatoire, avec Saint André (patron de l'Abbaye) Saint Géry (patron du Diocèse) et Saint Louis , patron des tisserands (l'industrie du tissu fut toujours florissante au Cateau). Les deux petits vitraux de la Chapelle Sainte Maxellende sont très réussi, d'allure moyenâgeuse et représentant Sainte Aldegonde (Abbesse et patronne de Maubeuge) et Sainte Reinelde. Les enfants, chantant les psaumes de louange et de miséricorde, aux trois verrières de la façade, forment une heureuse composition ; plus discutables sons les grands vitraux du transept, les rosaces et les Sept Sacrements des hautes fenêtres de la croisée.
La vie de Saint Martin illustre et illumine, les jours de soleil, la nef : des légions de moines, aux silhouettes de fantômes, y rappellent les étapes monastiques de son existence ; ils évoquent aussi les Bénédictins de Saint André qui, 9 siècles durant, prièrent ici et qui continuent leur mission de gardiens invisibles mais vigilants de la cité.
Dr Pierre Tison (1940)
Texte retranscrit par Christiane Bouvart
Consulter ou télécharger les scans de l'original: Consulter ou télécharger la retranscription: